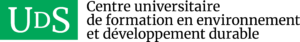Contenu riche et diversifié. Constats souvent inquiétants, pour ne pas dire alarmants. Lueurs d’espoir plutôt modestes… Cette première livraison de la revue Le Climatoscope offre à ses lecteur.rice.s un menu substantiel – de la bonne « nourriture pour l’esprit », comme le veut la formule. Et elle envoie
le message qu’il faut envoyer et renvoyer, encore et toujours: il y a grand péril en la demeure.
Grand péril parce que, partout dans le monde, toutes les observations concordent. Indéniablement, la marmite du climat est sur le feu. Et tout aussi indéniablement, l’eau chauffe. Mais nous ne la regardons pas chauffer de l’extérieur : comme les grenouilles de la fameuse fable, nous sommes dans la marmite. Tout particulièrement au Canada où, comme le rappelle l’état des lieux qui ouvre ce Climatoscope, « le réchauffement enregistré jusqu’à présent [de 1948 à 2016] est environ deux fois plus important que celui constaté à l’échelle planétaire » : 1,7 °C au Canada contre 0,8 °C en moyenne sur la planète. Sans reprendre toutes les données de cet état des lieux, soulignons que le réchauffement a été encore plus marqué dans le Nord du pays. Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, il s’est élevé à 2,3 °C, « ce qui correspond à trois fois le réchauffement moyen mondial ».
Faut-il encore le dire ? Les signes que la marmite chauffe sont légion. Les années les plus chaudes jamais enregistrées se multiplient ; les records de chaleur battent rapidement les précédents records de chaleur ; les épisodes de canicules, de sécheresses ou de pluies diluviennes se font plus fréquents ; des kilomètres carrés de forêt disparaissent dans d’immenses incendies ; les glaciers et les banquises fondent, le niveau des océans
grimpe ; les récifs coralliens disparaissent à toute allure ; la flore et la faune en prennent pour leur rhume et essaient tant bien que mal de s’adapter plutôt que de disparaître (et les espèces semblent plus souvent perdre que gagner à ce jeu-là) ; la perte de biodiversité, due en partie au dérèglement du système climatique, est telle qu’on évoque parfois une « sixième extinction ». Bref, le climat devient « fou ».
Mais si la Terre est en train de se transformer en une « étuve » qui deviendrait « invivable » ou « inhabitable » pour l’humanité, comme le suggère une étude publiée en 2018 par les Proceedings of the National Academy of Sciences des États-Unis(1), si nous sommes près d’un point de non-retour ou même déjà engagé.e.s dans l’apocalypse climatique, comme le clament parfois les médias, pourquoi les grenouilles ne sautent-elles pas
hors de la marmite ? Parce qu’elles ne ressentent pas la graduelle augmentation de la température et s’y habituent peu à peu… jusqu’au moment où il sera trop tard pour réagir et où elles mourront cuites, comme le raconte la fable ? Ou parce que les bords de la marmite sont tout simplement trop hauts pour elles ?
Autrement dit, sommes-nous pieds et poings liés face à une société et à une économie qui carburent, littéralement, aux énergies fossiles ? C’est ce que j’ai tendance à penser dans mes moments de pessimisme, que d’aucuns qualifieront de réalisme. Malgré les avertissements des scientifiques et les belles promesses des politicien.ne.s, malgré les succès apparents de la « diplomatie du climat » (dont le célèbre Accord de Paris, approuvé par près de 200 pays lors de la vingt-et-unième Conférence des Parties, en décembre 2015), le fait brutal est que les émissions de CO2 et autres GES, les gaz à effet de serre, continuent d’augmenter. Le fait est, également, qu’une énorme proportion de l’énergie consommée dans le monde provient toujours et encore des combustibles fossiles – en gros, le charbon, le pétrole et le gaz fournissent plus des quatre cinquièmes de l’énergie de la planète. Ce qui veut dire que le système économique mondial est lourdement dépendant du marché du carbone, et ce n’est pas pour rien que le pétrole, dont la production est en hausse, est depuis longtemps surnommé « l’or noir ».
Dans mes moments de réalisme (ou de pessimisme…), je vois bien les énormes difficultés politiques d’un passage au « moins de carbone » dans le bilan énergétique mondial. Au Canada, le bras de fer entre les pro et les anti « pétrole sale » des sables bitumineux est d’une rare vigueur. Et l’opposition à la taxe carbone fédérale est tout aussi vigoureuse. Aux États-Unis, la victoire de l’inénarrable climatosceptique Trump a été qualifiée de « victoire du charbon ». Un peu partout dans le monde, la montée des populismes de droite n’annonce pas des jours meilleurs pour la mise en application des recommandations des scientifiques du climat.
Quant aux difficultés économiques de ce passage au « moins d’énergies fossiles », on en mesure l’ampleur en lisant une étude publiée au début de 2015 dans l’hebdomadaire scientifique Nature.(2) Les auteurs de cette étude avançaient que, pour ne pas dépasser une augmentation de la température moyenne de 2 °C, il faudrait laisser dans le sol au moins 30 % du pétrole (et 75 % du pétrole provenant des sables bitumineux), 50 % du gaz et 89 % du charbon – autrement dit, laisser dans le sol des milliards et des milliards de dollars, ce qui semble pour le moins difficile à imaginer !
Cela dit, peut-on se laisser abattre par le pessimisme et ne rien faire, ou ne rien tenter de faire, en attendant d’être complètement cuit dans la marmite ? Certainement pas. Dans mes moments d’optimisme, que d’aucuns qualifieront d’idéalisme rêveur, je me mets donc à penser que tout n’est pas fichu. Et que la catastrophe annoncée peut encore être évitée, comme le laisse espérer le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dans un rapport spécial publié en octobre 2018 dans la foulée de l’Accord de Paris, Global Warming of 1.5 °C.(3) Selon l’étude du GIEC, limiter le réchauffement à 1,5 °C est un objectif atteignable, mais ambitieux puisqu’il faudrait parvenir à la « neutralité CO2 » (émissions nettes nulles) vers 2050.
Ambitieux, donc, mais pas complètement irréaliste. Si, politiquement et économiquement, « décarboniser » l’économie s’annonce une tâche difficile, ce n’est pas impossible techniquement. D’abord, parce que les techniques de production d’énergies renouvelables ont monté en puissance. Une première, symbolique, s’est produite aux États-Unis en avril 2019: l’électricité provenant de sources renouvelables a temporairement dépassé l’électricité provenant des centrales au charbon (temporairement parce qu’avril est un moment de basse demande, pendant lequel de nombreuses centrales au charbon sont arrêtées pour en faire la maintenance).
Ensuite, parce que les coûts des moyens de production des énergies renouvelables ont considérablement diminué – de quelque 80 % de 2008 à 2015 pour les panneaux photovoltaïques. Comme le soulignait un rapport publié en mars 2019 par l’organisme californien Energy Innovation(4), le 74 Percent Report, 74 % de l’énergie produite par les centrales au charbon américaines pourraient d’ores et déjà être remplacés par de l’énergie solaire ou éolienne moins chère.
Deux chercheurs de Californie, Mark Jacobson et Mark Delucchi, ont déjà calculé qu’en 2030, le cocktail EVS (pour eau, vent, soleil) pourrait fournir toute l’électricité mondiale.(5) « À l’évidence, [notaient-ils dans Scientific American,] il existe suffisamment d’énergies renouvelables pour couvrir les besoins de la planète. » Selon leurs calculs, les besoins mondiaux en 2030 seront de 17 térawatts (milliards de kilowatts) de puissance instantanée ; or, le potentiel mondial en éolien serait de 40 à 85 TW, et le potentiel en solaire de 580 TW. On note cependant qu’il faudrait des investissements massifs pour atteindre cet objectif: un demi-million de turbines marémotrices, plus de 5 000 usines géothermiques, près de 300 nouveaux barrages, presque 4 millions d’éoliennes, 1,7 milliard de panneaux solaires sur les toîts et quelque 89 000 centrales solaires. Ouf !
La grande faiblesse de sources d’énergie renouvelables comme le solaire et l’éolien, c’est leur intermittence. Mais là encore, des solutions technologiques pointent le bout du nez. Des batteries qu’on pourrait dire industrielles deviennent réalité. La ville de Los Angeles s’est entendue en juillet 2019 avec la firme 8minute Solar Energy sur la construction d’une méga-centrale solaire dotée de méga-batteries, une installation qui fournira 7 % de l’électricité de la ville d’ici 2023, et ce, à moins de 2 cents le kilowatt.
Bien sûr, cette spectaculaire transition énergétique n’est pas sans poser elle-même des problèmes techniques et ne se fera pas à coût écologique zéro. Par exemple, certains matériaux ou composants des systèmes de production d’énergie verte peuvent être rares et venir à manquer. C’est le cas du néodyme utilisé dans les engrenages des éoliennes et dont 90 % des réserves connues se trouvent en Chine. C’est aussi le cas du tellure de cadmium et de l’indium pour les cellules photovoltaïques. Ou encore du lithium pour les batteries: certains se demandent si les réserves mondiales seraient suffisantes pour équiper des dizaines de millions de véhicules électriques.
Et surtout, cette transition énergétique ne se fera pas aussi vite qu’on pourrait l’espérer. Selon Vaclav Smil, spécialiste de l’énergie à l’Université du Manitoba, chaque passage entre deux combustibles (du bois au charbon, du charbon au pétrole, et actuellement du pétrole au gaz naturel) a pris de 50 à 60 ans.(6) « À l’échelle mondiale, [souligne-t-il,] les investissements et les infrastructures nécessaires pour qu’une nouvelle source d’énergie s’impose requièrent deux à trois générations. » Bien sûr, ajoute-t-il, « de nombreuses raisons environnementales poussent à réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles ». Mais la meilleure carte à jouer, pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables, serait encore de « réduire la consommation énergétique mondiale ».
Quoi qu’il en soit, et cela aussi suscite en moi un optimisme mesuré, le vent politique et économique commence à tourner en faveur des énergies renouvelables. Michael Bloomberg, l’ancien maire de New York, a annoncé au début de juin 2019 qu’il donnera 500 millions de dollars pour la campagne Beyond Carbon. Cette campagne vise notamment la fermeture de toutes les centrales au charbon américaines (280 ont fermé depuis 2010, il en reste presque autant). Selon lui, « le moment est venu pour que chacun d’entre nous reconnaisse que le changement climatique est le défi de notre temps. »
Sur le plan politique toujours, et même si les engagements nationaux de réduction des émissions de GES ne sont pas mirobolants, la communauté internationale n’a pas baissé les bras depuis l’Accord de Paris. Témoin en est le Sommet Action Climat convoqué par les Nations Unies le 23 septembre 2019. Des dizaines de médias, dans le monde, se sont engagés à accorder une attention toute particulière à la question du climat pendant ce Sommet, dans le cadre du projet Covering Climate Now.
Sur le terrain, les choses bougent aussi. La Californie s’attaque vigoureusement à la « décarbonisation » de sa production électrique et, de façon générale, à la lutte aux changements climatiques – et cela sans s’occuper ni de Washington, ni de Trump, ni des climatosceptiques. En Norvège, le parti Travailliste a annoncé, en avril 2019, le refus du pays de forer au large des îles Lofoten, en Arctique ; pourtant, les réserves de pétrole estimées sont de l’ordre de 1 à 3 milliards de barils. À noter également que, selon un relevé de juillet 2019 effectué par Mark Jacobson, de Stanford University, 54 pays et 8 états américains visent 100 % d’électricité de sources renouvelables dans un avenir plus ou moins rapproché.
Le 20 juillet 2019, alors qu’on célébrait le 50e anniversaire des premiers pas de l’humanité sur la Lune, un journaliste du New York Times, John Schwartz, se demandait pourquoi l’on ne pourrait pas faire pour le climat ce qu’on avait fait pour la Lune.(7) Il notait que la question du climat est plus complexe qu’aller sur la Lune. Que la réussite de la mission Apollo ne demandait pas un changement de mentalités. Et, surtout, que l’objectif d’aller sur la Lune n’était pas combattu par de puissants lobbys industriels et économiques, comme c’est le cas dans la question du climat. Pour rééditer l’exploit de la Lune, concluait-il en substance, il faudrait une technologie appelée… volonté politique. J’ajouterais qu’il faudrait également, pour être réaliste, que l’économie penche du bon côté, puisque ce sont bien plus les dollars que les professions de foi écologistes qui pèseront dans la balance de la transition énergétique.
Alors, pessimisme ou optimisme ? Entre les deux, ma raison balance. Mais elle me dit aussi que, si nous sommes bel et bien des grenouilles dans la marmite, nous ne pouvons pas ne pas essayer de toutes nos forces de sauter par-dessus ses bords. Si hauts soient-ils.