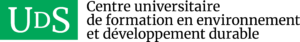Une municipalité subit d’importantes inondations ? L’événement fait la manchette du téléjournal. Des images presque familières se succèdent : des maisons devenues des îles sont entourées d’eau trouble, une pelle mécanique servant à évacuer des familles se fraie un chemin entre les blocs de glace qui flottent, des personnes empilent des sacs de sable. Un journaliste en bottes de caoutchouc résume la situation, les pieds dans l’eau. Parfois, une ou deux personnes témoignent de ce qu’elles ont vécu au plus fort de l’inondation. Mais qu’arrive-t-il à ces personnes quand l’eau se retire et que les caméras s’éteignent ? À l’exception des brèves entrevues enregistrées dans le feu de l’action, que sait-on de l’expérience des personnes sinistrées ? Est-ce que les personnes que l’on entend dans l’espace public représentent la diversité des populations touchées ?
Des représentations inégales et des effets différenciés
Dans les récits qui circulent sur les événements météorologiques extrêmes (EME), comme les inondations, les différents groupes touchés directement ou indirectement ne font pas tous l’objet des mêmes représentations. La couverture médiatique des EME dans l’actualité est orientée par différentes considérations qui influencent quels désastres sont couverts et sous quel angle, ce qui contribue à reproduire les hiérarchies sociales à l’œuvre dans les communautés sinistrées. Par exemple, les populations qui présentent différentes vulnérabilités peuvent être représentées essentiellement comme des victimes en attente de soutien, ce qui invisibilise leurs capacités individuelles et collectives à faire face à l’événement et à se relever (Few et al., 2021).
Les événements désignés comme des catastrophes naturelles sont aussi des phénomènes sociaux. En effet, les conséquences des aléas d’origine climatique ou géophysique découlent de facteurs sociaux (pour un panorama historique et contemporain de la définition des catastrophes, voir Gonzalez Bautista, 2022). Ainsi, les personnes qui se trouvent dans des situations défavorables pour des raisons liées à la géographie, à la pauvreté, au sexe, à l’âge, au handicap ou à leur appartenance ethnique subissent des effets plus importants que celles qui sont plus privilégiées (Hrabok et al., 2020). Les personnes désavantagées socialement sont en effet plus à risque d’être exposées à des EME, et elles ont moins de ressources pour y faire face et s’en remettre. Par exemple, les logements situés dans des zones inondables sont souvent plus abordables et davantage occupés par des personnes en situation de pauvreté, ce qui augmente leur risque de subir des inondations (Lawrence-Bourne et al., 2020). Or, les pertes matérielles et les bris de service entraînés par un EME sont proportionnellement plus sévères pour ces personnes (Few et al., 2021).
Le genre est l’un des facteurs sociaux qui influencent les expériences d’un EME, ses conséquences et les ressources disponibles pour se relever (Enarson et al., 2018). Les inégalités de genre qui structurent les sociétés font que les femmes exposées à des EME sont plus susceptibles de vivre de la détresse psychologique, de la stigmatisation liée à leur recours aux soins et de la pauvreté associée au désastre (Lammiman, 2019). Les situations de désastres sont aussi des occasions de reproduction des inégalités de genre, ces événements étant souvent associés à une diminution des revenus des femmes, à une augmentation de leurs responsabilités familiales et à une hausse de la violence envers elles, entre autres (Enarson et al., 2018 ; Lammiman, 2019 ; Pfister, 2022).
Mieux comprendre pour mieux intervenir
Si les femmes tendent à subir des conséquences disproportionnées des EME, leurs expériences et leur expertise à ce sujet ne sont pas pour autant reconnues. Le milieu de la gestion des désastres continue d’être largement occupé par les hommes et porté par des institutions qui valorisent les caractéristiques et les modes d’organisation associés à la masculinité, comme l’armée et les services incendie (Enarson et al., 2018 ; Gonzalez Bautista, 2022 ; Pfister, 2022). Lorsque ces milieux intègrent des femmes et des personnes au genre non binaire, la pression pour ces personnes de se conformer aux normes de la masculinité traditionnelle est forte (Gonzalez Bautista, 2022). Dans un tel contexte, les préoccupations portées par les femmes sinistrées sont facilement ignorées (Few et al., 2021). Ainsi, l’absence de prise en compte du genre dans la gestion des désastres a des effets négatifs sur les femmes et les filles (Enarson et al., 2018).
Ces enjeux sont de plus en plus criants alors que les changements climatiques entraînent une augmentation de la fréquence et de la gravité des EME (GIEC, 2021). Il est donc essentiel de documenter un large éventail d’expériences d’EME pour mieux comprendre leurs conséquences sur le bien-être et les besoins d’une diversité de groupes.
La recherche centrée sur la parole et l’expérience des personnes sinistrées vise à amplifier les voix de ces personnes et à faire valoir leur point de vue. Donner la parole aux personnes et aux groupes qu’on entend peu permet d’identifier certains effets des EME qui autrement demeurent cachés, de même que des stratégies utilisées par les personnes pour se rétablir. Porter ces voix sur la place publique, les faire entendre aux institutions concernées dans la gestion des EME est une étape essentielle pour une gestion équitable des EME. Il s’agit aussi d’un acte de légitimation important pour les personnes concernées.
Méthode
La recherche, dont un aperçu est présenté ici, est menée dans le cadre d’un programme de doctorat interdisciplinaire en santé et société. Elle a été menée en Beauce auprès de femmes ayant fait face aux inondations de la rivière Chaudière. Cette rivière, qui traverse la région de Chaudière-Appalaches sur 193 km, fait partie des cours d’eau pour lesquels on a enregistré le plus d’inondations depuis que ces données sont recueillies (Mayer-Jouanjean et Bleau, 2018). Après les inondations particulièrement sévères de 2019, plus de 400 bâtiments ont été démolis dans les deux municipalités régionales de comté les plus touchées par le débordement de la Chaudière. Ces démolitions ont d’ailleurs touché plusieurs des participantes à l’étude.
Des entrevues avec 17 femmes sinistrées ont été réalisées en 2023. Une approche narrative a été retenue pour l’analyse afin de mettre en valeur les récits des participantes et de comprendre le contexte plus large dans lequel s’inscrivent leurs histoires. Ainsi, l’analyse qui a été menée a permis de mieux comprendre l’enchevêtrement des récits individuels, familiaux et culturels dont se servent les participantes pour donner du sens à leur expérience. Ici, des extraits des entrevues sont présentés sous forme de courts récits afin d’illustrer différentes conséquences des inondations de la rivière Chaudière sur les femmes sinistrées. Les citations ont été modifiées pour protéger la confidentialité des participantes, qui sont identifiées par des pseudonymes. Des passages ont aussi été écourtés pour faciliter la lecture.
Quelques histoires d’inondation
Une fois les caméras des médias éteintes, qu’est-ce que les femmes sinistrées ont à dire, si on leur tend le micro ? Leurs histoires montrent que les effets des inondations sur le bien-être sont multiples et qu’ils sont modulés par les réalités des personnes qui les subissent.
Les participantes qui avaient un plus faible revenu et moins de soutien de la part de leurs proches ont vécu des difficultés particulières. Lorsque leurs ressources étaient limitées, elles ont dû réaliser différentes démarches pour obtenir du soutien matériel et psychosocial, ce qui a été, en soi, une source de stress.
Tu retournes chez vous, ton frigidaire, il faut que tu le vides complètement et que tu le nettoies, ben c’est ben beau que le gouvernement te donne 500 $ dans six mois, mais t’as besoin de manger maintenant. Il y a-tu quelqu’un qui peut nous aider ? C’est pas tout le monde qui a 100, 200, 300 $ pour refaire une épicerie de base, là. Tu sais, aussi, l’aide psychologique, moi, je me suis battue pour être capable d’avoir de l’aide psychologique au privé avec [du soutien financier de] la Croix-Rouge, parce que je voulais avoir de l’aide, j’allais péter au frette. T’as besoin tout de suite, maintenant, là. J’ai juste besoin de parler, j’ai juste besoin de pleurer, que tu me regardes comme autre chose que quelqu’un qui vient juste de se faire ramasser toute sa vie par de l’eau.
(Valérie)
Si certains besoins se sont fait sentir immédiatement lors de la crue, les effets des inondations sur le bien-être des participantes et de leurs enfants ont parfois été ressentis intensément des années après l’événement.
Je me rappelle les premières rencontres présentielles [après le confinement lié à la pandémie de COVID-19], on se mettait à parler de ça, la détresse psychologique, puis je me mettais à brailler. Tu t’en vas aux toilettes, tu dis : « C’est quoi qui m’arrive, là ? » Puis c’est là que tu te rends compte : mon fils va avoir cinq ans, mais les quatre premières années ont été foutrement rock’n’roll dans ma vie. Sans arrêt tout le temps. Puis t’as personne pour te — tu sais, quand t’es monoparentale, t’as pas nécessairement personne pour t’appuyer.
(Josiane)
En plus de constituer une source de stress supplémentaire, la pandémie de COVID-19 a aussi limité l’accès à certaines ressources de soutien pour les personnes sinistrées.
L’aide qu’on a reçue pour ce côté-là, ç’a été au mois de janvier [2020]. Ils ont eu une rencontre avec une fille du CLSC, puis la COVID est arrivée. Fait que de l’aide psychologique, ils n’en ont pas reçu.
(Sabrina)
Les effets des inondations sur le bien-être sont parfois indirects, notamment lorsqu’ils sont liés aux programmes d’indemnisation, aux rénovations ou aux démolitions de bâtiments et à la lourdeur administrative qui entoure ces processus. Ces difficultés étaient particulièrement criantes pour certains groupes, comme les locataires, qui devaient composer à la fois avec l’incertitude découlant de la structure du programme d’indemnisation du gouvernement provincial et avec le manque d’informations fournies par leur propriétaire. Les participantes mères de jeunes enfants ont aussi témoigné de difficultés particulières vécues pendant la période où leurs demandes d’indemnisation étaient évaluées :
Je pense que c’est ça le bout qui a été stressant, c’est pas l’inondation, c’est tout ce qui s’est passé après qui a été plus difficile. On était comme vraiment dans une incertitude qui faisait en sorte que là, on pouvait pas prendre de décision, puis on pouvait pas prendre action. Puis c’est vraiment ça que mon conjoint puis moi on a trouvé difficile, surtout qu’on a de jeunes enfants. On peut pas se permettre de pas savoir c’est quoi la suite.
(Laura)
Si les participantes à l’étude ont vécu des difficultés liées à leur rôle parental, à leur bien-être et aux ressources limitées auxquelles elles avaient accès, leurs histoires permettent aussi d’identifier des besoins et des manières d’y répondre. En témoignant de leurs forces face à l’épreuve vécue, les récits des participantes permettent de brosser un portrait plus complet des personnes directement touchées par des inondations majeures.
Le lâcher-prise, ça je l’ai appris, puis c’est comme sauter dans le vide, tu veux faire de quoi de nouveau ou quelque chose, puis des fois, tu fais : « Ah non… » Ben moi ça me fait plus peur, je suis comme : « On veut changer de quoi ? Je suis prête à sauter dans le vide ! » Maintenant, j’ai moins peur de la vie. J’apprécie la vie là, tu peux pas savoir.
(Patricia)
Le monde m’écrivait sur Messenger, mais des fois, ils pouvaient passer deux heures à me jaser ça, à me raconter leur petite vie, leur petite histoire par rapport à leur maison. Je faisais des remarques aux gens pour les aider justement à sortir de là, à être capables de passer l’étape du deuil. Pour ma part, je vais toujours aider le monde puis je sais pas, juste le fait de comprendre ce que les gens vivent, j’ai l’impression que ça m’aide à comprendre moi-même ce que j’ai vécu. Je me suis apporté de l’aide en aidant les autres.
(Sabrina)
Conclusion
Les portraits des personnes sinistrées que nous présentent les médias et la culture populaire ne font pas que nous informer — ils teintent nos façons de nous représenter les populations touchées par des EME (Jensen, 2021). Cela a des répercussions sur la manière dont ces personnes sont vues par le public, mais aussi par les instances qui agissent en temps de crise pour soutenir les populations touchées. En plus des effets très visibles d’événements comme des inondations, les personnes touchées peuvent subir des effets moins connus, parfois déclenchés par la planification et la gestion des EME, comme c’est le cas lorsque les démarches requises pour recevoir une indemnisation sont plus stressantes que l’inondation elle-même.
La méthode adoptée dans cette recherche, présentée ici très brièvement, a permis de collecter des récits d’expérience riches et singuliers qui rendent plus tangibles les effets différenciés des EME, par exemple sur les femmes qui portent une large part ou l’entièreté de la charge parentale. Les histoires que les femmes racontent témoignent aussi des ressources matérielles et internes qu’elles ont su mobiliser pour se relever et soutenir leur communauté. Tenir compte de cette diversité d’expériences, de sources de vulnérabilité et de forces favoriserait une prise en charge plus équitable des personnes sinistrées à court, moyen et long terme.