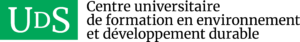La crise climatique actuelle engendre une multiplication des initiatives internationales pour contrer les effets dramatiques du changement climatique ainsi qu’accroître la résilience des communautés locales les plus vulnérables (Organisation des Nations unies [ONU], 2015). Ces initiatives tentent de mettre en place des modes de gestion des ressources et des territoires « plus durable » et en lien avec les agendas internationaux. Toutefois, les communautés locales concernées disposent aussi de savoirs et de pratiques en lien avec leurs traditions. Ainsi, toute initiative qui cherche à renforcer la résilience des communautés aux effets du changement climatique devrait s’accompagner d’une réflexion sur les relations entre ce qui est proposé et ce qui existe déjà, sans tenir pour acquis que ces catégories sont naturellement en opposition. Notre article démontre la complexité de ces considérations sur les plans épistémologique, méthodologique et opérationnel.
Nous nous appuyons sur une étude de cas au Sénégal, dans le cadre d’un projet de résilience accrue des îles du Saloum au changement climatique, financé par le Programme de coopération climatique internationale du Québec. Nos questions de recherche portaient sur les savoirs reconnus comme « endogènes », sur les continuités et les tensions entre ces savoirs et ceux que les communautés voient comme « extérieurs » ; et, sur les bouleversements récents qui ont entraîné la délégitimation de certains savoirs au profit d’autres.
Nos résultats montrent qu’il existe effectivement plusieurs éléments de continuité et de ruptures, mais nous avons aussi mis en lumière des savoirs en « concordance », c’est-à-dire qui n’ont pas les mêmes sources, mais qui produisent des effets similaires sur la protection et la conservation des écosystèmes.
Contexte historique et problématique
Les institutions internationales et les organisations non gouvernementales tentent, depuis la Convention sur la diversité biologique, d’intégrer les savoirs dits « traditionnels » dans les projets de résilience climatique. Le sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable de 2002 a plus que jamais relancé le débat autour de cette problématique (Landrieu, 2021). Dans plusieurs communautés, la colonisation a joué un rôle majeur dans la dévalorisation, voire la perte des savoirs locaux, étant donné que « l’impact colonial modifia toutes les sphères de la vie » (Coquery-Vidrovitch, 2005, p. 224).
Différentes critiques ont été formulées quant à l’intégration des savoirs traditionnels dans les projets de développement, notamment quant aux réelles motivations poussant les organisations internationales et les organisations non gouvernementales (ONG) à s’intéresser aux savoirs traditionnels, ainsi que sur l’efficacité, voire les retombées de leur intégration dans l’atteinte des objectifs de développement durable. L’argument que nous mettons de l’avant est quelque peu différent. Nous estimons que ces initiatives sont rarement accompagnées d’une réflexion sur la complexité théorique, méthodologique et opérationnelle d’une telle entreprise. C’est cette complexité que nous présentons.
Complexité épistémologique
L’expression « savoir traditionnel » est devenue très populaire dans les dernières décennies. Nous la retrouvons dans les projets de développement international, dans le monde universitaire, ainsi que dans le langage courant. Toutefois, la première complexité que nous relevons provient de la question suivante : qu’est-ce qu’un « savoir traditionnel » ? Cette question laisse place à deux sous-questions : qu’est-ce qu’un « savoir » ? Et que signifie « traditionnel » ?
Nous répondons à la question en regardant l’usage qui en est fait dans les organisations internationales et les publications scientifiques. Par exemple, selon l’UNESCO (2021), les savoirs traditionnels renvoient aux connaissances, au savoir-faire et aux philosophies développés par des sociétés ayant une longue histoire d’interaction avec leur environnement naturel. Les savoirs traditionnels font référence à « ce qui relie les hommes d’aujourd’hui aux hommes d’hier, c’est-à-dire l’interprétation par des sociétés contemporaines de ce qu’elles ont reçu de celles qui les ont précédées » (Roué, 2012, p. 4).
Si nous nous intéressons de près à cette expression, nous remarquons qu’elle est aussi souvent utilisée de façon interchangeable avec d’autres expressions similaires, telles que : « savoir autochtone », « savoir local », « savoir endogène », « ethnoscience », et ainsi de suite. Ces expressions existent toujours dans un rapport dichotomique, binaire, en opposition avec, par exemple, le savoir moderne, le savoir scientifique, le savoir occidental, la science, etc.
Cet article démontre que le concept de « savoir traditionnel » n’est pas nécessairement le plus productif pour prendre en compte la diversité des savoirs et pratiques en lien avec la gestion des ressources naturelles. Au lieu de s’attarder aux débats sémantiques et épistémologiques entourant le concept, il est possible de se baser sur les conceptions dites « émiques ». Ainsi, au lieu de mobiliser la catégorie « savoir traditionnel » et de tenter, grâce à cette catégorie, de trouver des éléments qui en relèvent, une autre option est de s’intéresser directement aux pratiques de gestion des ressources naturelles qui sont perçues par les communautés comme étant les leurs, en opposition à celles qui sont perçues comme provenant de l’extérieur. C’est cette approche qui a permis de mettre en lumière les récits locaux sur les bouleversements socio-économico-politiques qui ont eu des conséquences sur les pratiques locales et qui ont permis de porter attention aux conditions historiques de la délégitimation de certains savoirs au profit d’autres.
Nos résultats démontrent que les savoirs dits « modernes » et « traditionnels » en matière de gestion des ressources, dans les îles du Saloum, sont souvent similaires dans la pratique, mais ils sont différents dans leur source d’autorité et dans la façon dont ils sont communiqués. Par exemple, le « repos biologique » dans les cours d’eau, imposé juridiquement par les services de l’État sénégalais, par l’intermédiaire des comités locaux de pêche, est très semblable à ce qui était pratiqué avant que ces règlements soient imposés. Toutefois, nos interlocuteurs et interlocutrices marquent une distinction linguistique et une nuance entre les deux. Ce résultat montre que les catégories « traditionnel » et « moderne » ne sont pas toujours réellement en opposition dans la pratique.
Complexité méthodologique et opérationnelle
D’un point de vue méthodologique, nous abordons les limites des méthodes d’enquête traditionnellement employées par les ONG pour reconnaître et valoriser les savoirs dits traditionnels. Dans les îles du Saloum, par exemple, il existe une longue histoire de présence d’ONG étrangères qui viennent avec des « projets de développement » et repartent à la fin du financement. La méthode préconisée pour obtenir des informations sur les communautés avec lesquelles elles travaillent est souvent analogue à un « groupe de discussion » : un groupe ciblé est regroupé, puis des questions sont posées, quelques porte-parole s’expriment, et le groupe valide. Bien souvent, cette façon de faire mène à des données biaisées, erronées ou partielles. C’est un constat partagé avec plusieurs acteurs et actrices du milieu : il est difficile de faire ressortir les réelles volontés, expériences ou préoccupations des personnes rencontrées. Ce blocage relève des dynamiques historiques, économiques et sociales qui façonnent les relations entre ONG
et communautés, mais elles sont aussi le résultat des méthodes employées pour produire les informations désirées pour justifier le bien-fondé des initiatives financées.
Les ONG sont aussi rarement outillées sur le plan méthodologique pour faire ce type de recherche. Par exemple, bien souvent, les ONG ne ciblent qu’une petite portion de la population à travers certains critères, tels que « les jeunes » ou « les femmes ». La politique féministe internationale du Canada, par exemple, a poussé les ONG canadiennes à travailler presque exclusivement avec des femmes. Or, cela mène parfois à des biais dans les interventions et les résultats. La recherche présentée s’est ainsi distanciée de ces façons de faire, pour plutôt impliquer une diversité d’acteurs et d’actrices et ainsi avoir un portrait plus complet et nuancé : des femmes, des hommes, des autorités traditionnelles, des personnes âgées, des jeunes, ainsi que des personnes s’activant dans la protection et la conservation des écosystèmes avec les services de l’État ou des instances plus locales.
Nos résultats ont confirmé que les pratiques locales de gestion des ressources basées sur les savoirs traditionnels sont mieux considérées par les communautés des îles du Saloum, même si de nouvelles pratiques arrimées aux agendas internationaux y sont introduites. L’accentuation des problématiques de durabilité, particulièrement celle d’ordre socio-environnemental, a mené à la recherche de solutions par les acteurs gouvernementaux appuyés par des bailleurs internationaux, et ce, généralement aux dépens des normes et prescriptions des communautés locales. Résistant de ce fait aux nouvelles politiques et techniques qui leur sont souvent imposées, ces dernières souhaitent préserver leurs savoirs et pratiques traditionnels.
Conclusion et leçons apprises
Cette recherche s’inscrit dans une perspective décoloniale qui déconstruit l’universalisme hégémonique en mettant les savoirs et les pratiques des communautés locales au-devant de la scène. Nous avons présenté la complexité théorique, méthodologique et opérationnelle de la reconnaissance des savoirs traditionnels dans les projets de résilience aux effets du changement climatique.
Dans les communautés insulaires du Saloum, au Sénégal, plusieurs pratiques locales issues des savoirs traditionnels permettent de protéger et de conserver au mieux les écosystèmes. D’après nos résultats de recherche, il existe à la fois des continuités et des ruptures dans les savoirs et les pratiques de gestion des ressources naturelles. Toutefois, nous avons aussi mis en lumière des savoirs et des pratiques sur la protection des écosystèmes, que nous avons qualifiés de « concordants », c’est-à-dire qui ne sont pas en continuité historique, mais qui ont des effets similaires.
Nos résultats soutiennent notre hypothèse sur l’existence de dynamiques de dépossession et de remplacement des pratiques endogènes. En effet, plusieurs règlements étatiques sont présentés comme étant nouveaux, alors qu’ils sont en continuité ou concordants avec des pratiques précédentes. La différence provient souvent de la façon dont est nommée la pratique. Ainsi, les agences étatiques promeuvent le « repos biologique ». Les populations y voient quelque chose de nouveau, alors qu’elles pratiquaient aussi une rotation des activités qui permettaient aux ressources de se régénérer et de se renouveler, avant l’arrivée des règlements des services de l’État. La pratique reste la même. Seulement, la désignation n’est pas la même.
Outre ce qui a déjà été discuté, nous ajoutons quelques éléments pour la mobilisation des résultats dans le projet soutenu par le programme de coopération climatique internationale du Québec et dans d’autres projets similaires. Concernant la remarque sur la méthodologie, il serait pertinent de diversifier les interlocuteurs et interlocutrices pour nuancer les points de vue exprimés. Il est vrai que nous travaillons prioritairement avec les femmes, mais pour avoir un portrait plus complet des dynamiques dans lesquelles s’insèrent les projets, nous devons nous assurer d’avoir les enjeux et les défis partagés à l’échelle des communautés. Cela est aussi nécessaire si on veut s’assurer que les projets internationaux ne viennent pas bousculer les normes et prescriptions en vigueur.
Comme nous l’avons montré, beaucoup de pratiques de gestion « moderne » sont en réalité en continuité avec des pratiques de gestion « traditionnelle ». Il serait aussi intéressant de montrer de l’intérêt pour les éléments de sacralisation qui, même s’ils ne relèvent pas de la même source de savoirs, ont aussi un effet de conservation qui est hautement valorisé par les populations. Outre cet aspect, il serait judicieux de se baser sur les savoirs et pratiques endogènes qui ont fait leurs preuves. Il pourrait être pertinent de travailler à leur transfert entre les personnes aînées et les jeunes pour garder la spécificité territoriale.