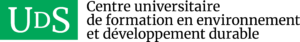« You can’t build your way out of congestion »
Lors d’un séjour de recherche chez nos voisins du Sud, je me suis étonnée d’entendre un responsable de la planification des transports d’une grande métropole américaine affirmer que la congestion routière n’était pas un problème, car celle-ci représenterait un signe de vitalité économique. Selon d’autres intervenant.e.s rencontré.e.s lors du même séjour, aspirer à une absence de congestion n’est pas souhaitable, car le réseau routier est conçu pour absorber le pic de trafic à l’heure de pointe du matin; ne pas avoir de congestion à l’heure de pointe signifie donc que le réseau routier est en surcapacité. Pourtant, les coûts environnementaux, sociaux et économiques liés à la congestion routière sont bien réels et ceux-ci affectent quotidiennement la santé, la qualité de vie et le portefeuille de tous et de toutes les citoyen.ne.s, qu’ils et elles soient conducteur.rice.s, passager.ère.s, résident.e.s ou contribuables. La congestion est-elle un problème? Si tel est le cas, comment la réduire?
Ce texte présente les effets de la congestion et explique les fondements scientifiques de la notion contre-intuitive de la demande induite en transports en vertu de laquelle une augmentation de la capacité routière ne fait qu’accroître la circulation. Il aborde également l’efficacité des mesures visant à atténuer la congestion, notamment les transports collectifs et l’écofiscalité. Quelques pistes de réflexion sur le leadership politique et la prise de la décision basée sur les données probantes sont offertes en guise de conclusion.
Conséquences de la congestion routière
La capacité du réseau routier représente le nombre de véhicules maximal pouvant circuler sur une voie pendant une certaine période de temps, à une certaine vitesse et sous certaines conditions. Elle est généralement déterminée à l’avance, en fonction des prévisions de la demande de pointe (celle du matin), par les ingénieur.e.s civil.e.s qui planifient les travaux routiers.
Quant à la congestion routière, celle-ci se définit comme étant une circulation en accordéon où les véhicules roulent au ralenti ou en mode « arrêt-départ ». Elle peut être de nature incidente, lorsqu’elle est causée par un accident ou un chantier de construction, par exemple, ou de nature récurrente, lorsque la quantité de véhicules sur le réseau routier excède la capacité de celui-ci. Quant à la mesure de la congestion, celle-ci ne fait pas consensus dans littérature scientifique. Elle peut être déterminée en pourcentage d’une valeur cible (p. ex. lorsque les véhicules roulent à 60 % de la vitesse à écoulement libre), ou en valeur cible (p. ex. lorsqu’ils roulent à moins de 25 km/h dans une zone de 100 km/h) (Tessier, 2015, p. 7-8)(1).
Les conséquences de cette circulation discontinue se mesurent généralement en termes de temps additionnel de déplacement, auquel sont associés les coûts liés à l’utilisation additionnelle des véhicules (carburant, usure et entretien). Certaines études comptabilisent également les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les conséquences des accidents supplémentaires générés par le temps additionnel passé dans le trafic. La congestion entraîne également d’autres coûts directs et indirects souvent non chiffrés, comme l’usure prématurée des routes et l’impact sur la santé des populations.
Ainsi, les coûts socioéconomiques de la congestion dans la région métropolitaine de Montréal auraient atteint 4,2 G$ en 2018 (Conseillers ADEC, 2018)(2), une estimation comparable ou cohérente avec les résultats de Toronto (3,3 G$ en 2008) (GTTA, 2008)(3) et la moyenne des 15 plus grandes métropoles américaines (5,2 G$ USD en 2014) (TTI, 2015)(4). Selon les plus récentes données compilées par la firme INRIX, Montréal serait la deuxième ville la plus congestionnée au Canada, avec un total de 145 heures perdues par habitant.e dans le trafic à l’heure de pointe en 2018, après Toronto, qui occupe le premier rang des villes canadiennes avec 167 heures perdues par habitant.e, et avant Québec, au neuvième rang avec 85 heures perdues par habitant.e (INRIX, 2018)(5).
Outre ses impacts socioéconomiques, la congestion routière accroît la pollution atmosphérique produite par la combustion des énergies fossiles par les moteurs, ce qui a pour conséquences un accroissement des problèmes respiratoires, des décès prématurés ainsi que plusieurs types de cancers, et ce, particulièrement pour les populations limitrophes, souvent défavorisées (McCubbin et Delucchi, 2003)(6).
Les véhicules à essence et au diesel émettent également du dioxyde de carbone (CO2), un puissant GES responsable du réchauffement climatique (Black, 2010)(7). Au Canada, le secteur des transports (routier, aérien, maritime, ferroviaire et hors route) est la deuxième plus importante source d’émissions de CO2, représentant 28 % des émissions totales (ECCC, 2019)(8). Au Québec, le transport génère la plus importante source d’émissions de CO2, avec 43 % des émissions totales en 2016, dont 80 % provenaient des transports routiers (MDDELCC, 2018)(9). Une analyse plus fine de l’inventaire québécois révèle que les émissions de CO2 provenant des transports routiers ont augmenté de 52 % entre 1990 et 2016, dont l’essentiel est attribuable aux émissions des camions légers (+125 %) et des véhicules lourds (+171 %) (TRANSIT, 2018)(10). Bien que les émissions de GES attribuables spécifiquement à la congestion routière ne soient pas systématiquement inventoriées, celles-ci servent souvent à justifier les nouveaux projets routiers. Mais pourquoi la congestion persiste-t-elle, malgré les interventions gouvernementales visant à la réduire?
Loi fondamentale de la congestion routière et demande induite en transports : « Si vous les construisez, ils vont conduire! »
La réponse des gouvernements aux problèmes persistants de congestion et de ses conséquences néfastes a généralement été d’augmenter la capacité routière, soit en construisant de nouvelles routes, soit en ajoutant des voies aux routes existantes. Or cette mesure s’avère inefficace, car contrairement au sens commun, l’augmentation de la capacité ne fait qu’accroître l’utilisation des véhicules. En effet, les nouvelles routes engendrent une demande supplémentaire équivalente à la nouvelle capacité. Ce quasi-équilibrage naturel entre la demande et l’offre explique le fait que les voies atteignent les niveaux de congestion préexpansion entre 5 et 10 ans après la construction de nouvelles voies (Duranton et Turner, 2011)(11). Ce qu’Anthony Downs avait appelé « la loi fondamentale de la congestion autoroutière » en 1962 a depuis été confirmé par un grand nombre d’études scientifiques prenant en compte différents types de routes et de régions métropolitaines dans différents pays, à différents moments, ainsi que différents facteurs comme le climat, le prix du carburant, le revenu des ménages et la croissance de la population(12).
À quoi peut-on attribuer cette loi contre-intuitive de la congestion routière? Le nouveau trafic causé par l’augmentation de la capacité routière, communément appelé la « demande induite », provient de quatre sources : 1) l’augmentation du camionnage et du trafic commercial; 2) le changement des habitudes de déplacement des individus et des ménages; 3) la migration de la population; et, dans une moindre mesure, 4) le détournement du trafic provenant d’autres voies (Duranton et Turner, 2011). La logique est simple : à court terme, le nouveau segment routier diminue les temps de déplacement, donc les coûts, ce qui incite les individus et les entreprises à voyager davantage, à changer d’heure de départ ou d’itinéraire, à choisir la voiture plutôt que les transports en commun, à déménager plus loin des lieux d’emploi, etc. Cette augmentation de la demande vient donc, à moyen terme, compenser de manière proportionnelle la nouvelle offre routière, et, du même coup, la réduction des émissions de GES qui auraient pu être associée à une diminution de la congestion, d’où l’expression « you can’t build your way out of congestion » ou « on ne peut se sortir du trafic en construisant des routes ».
Qui plus est, le réseau routier peut ne pas être utilisé à sa capacité optimale par les usager.ère.s, car ceux et celles-ci prennent une décision individuellement quant à l’itinéraire le plus rapide pour leur déplacement, et ce, indépendamment des choix des autres. En effet, les usager.ère.s n’ayant aucun incitatif à changer de trajet, ils et elles peuvent choisir d’emprunter une route et que celle-ci ne s’avère pas être la plus rapide, dû aux choix concourants des autres usager.ère.s de la route. Ainsi, l’ajout d’une voie de circulation peut augmenter le temps total de déplacement sur l’ensemble du réseau, et vice-versa1. Si les nouvelles voies ne réduisent pas la congestion, pourquoi alors continue-t-on d’en construire?
Outre la congestion, un autre argument souvent évoqué pour justifier l’augmentation de la capacité routière est celui de la création d’emploi et du développement économique. Bien que les infrastructures routières créent de l’emploi lors de leur construction, et bien que l’augmentation des déplacements engendre des bénéfices économiques liés aux activités générées (livraison, navettage, activités sociales), ces déplacements induits engendrent des coûts importants en termes de pollution, d’émissions de GES et de congestion. De plus, la plupart des études n’ont pas observé de lien entre, d’un côté, l’augmentation de la capacité routière et, de l’autre, l’emploi et l’activité économique. En effet, c’est plutôt un déplacement de l’activité économique à travers une même région métropolitaine qui est constaté (Handy, 2005)(13). Par exemple, les entreprises effectuant la production et l’exportation de biens lourds à transporter vont être localisées le long de la nouvelle infrastructure routière, mais cela n’aura pas d’effet important sur la valeur totale de la production (Duranton, Morrow et Turner, 2014)(14). L’augmentation de la capacité routière semble ainsi être une fausse bonne idée qui, en plus d’être inefficace pour atténuer la congestion, ne comporte peu ou pas d’effets directs et indirects positifs pour les régions urbaines, que ce soit en termes économiques, sociaux ou environnementaux.
Efficacité des interventions publiques
L’accroissement de la capacité routière ne permettant pas véritablement d’endiguer les problèmes de congestion, comment améliorer la fluidité de la circulation routière? L’augmentation des transports collectifs est souvent mise de l’avant comme étant la principale solution alternative à la construction de voies additionnelles ou de nouvelles routes. Cependant, conformément à la loi fondamentale de la congestion, l’espace libéré par l’utilisation des transports collectifs est compensé par la demande additionnelle qu’il crée, ce qui en fait aussi une mesure inefficace pour réduire la congestion (Duranton et Turner, 2011). En fait, si l’objectif est uniquement de faire diminuer le trafic automobile, la seule méthode efficace du côté de la gestion de l’offre est la réduction de la capacité routière, car la loi de la congestion routière fonctionne également en sens inverse : on fait référence alors à la « demande réduite ». En plus de faire diminuer la demande de déplacements, le retranchement du nombre de voies et la restriction de la circulation comportent également des bénéfices sociaux, environnementaux et économiques mesurables et documentés (Cairns, Atkins et Goodwin, 2002)(15). Quant aux systèmes de transport intelligents, ceux-ci permettent de maximiser l’utilisation des infrastructures existantes en temps réel, augmentant ainsi la fluidité de la circulation. Cependant, la diminution des temps de déplacement faisant, à terme, augmenter la demande en transport, ces systèmes ne constituent pas une solution viable afin d’atténuer la congestion routière.
Plusieurs outils permettent de gérer la demande en transport, c’est-à-dire la quantité et le type de véhicules sur les routes, ainsi que les horaires de déplacement. D’abord, l’imposition de mesures écofiscales, comme la taxe sur l’essence, la tarification au kilométrage et la taxe sur les stationnements, peuvent contribuer à réduire l’utilisation des véhicules, car une augmentation des coûts de déplacement fait diminuer la demande. De plus, l’écofiscalité incite également les automobilistes à emprunter les modes de transports collectifs et actifs, pour autant que ces choix s’offrent à eux. Ainsi, une étude révèle qu’augmenter la taxe sur l’essence à 0,46$/L au Québec et instaurer une tarification routière de 0,15$/km dans le Grand Montréal permettrait d’atteindre le quart de la cible québécoise de la réduction des émissions des GES provenant des transports2, en plus d’augmenter l’utilisation des transports collectifs de presque 40 % (TRANSIT, 2018).
Outre l’augmentation du coût des déplacements motorisés, les dirigeant.e.s ont également accès à plusieurs autres mesures de gestion de la demande qui possèdent des niveaux d’efficacité, de complexité, de coûts et de temporalité variables. Celles-ci incluent notamment le télétravail, les horaires variables, la gestion du stationnement et les politiques de croissance dite « intelligente », lesquelles permettent de réduire les distances de déplacement et la nécessité ou la volonté de les effectuer en automobile3. La réduction des besoins de déplacements ainsi que le réaménagement de l’espace autrefois dédié à la circulation automobile et aux stationnements ont également des conséquences positives sur la santé publique, la qualité de vie urbaine, les valeurs foncières, la consommation locale, etc.
Choix politiques basés sur des données probantes : comment passer du populisme à l’acceptabilité sociale?
Comment parvenir à effectuer les choix de planification les plus efficaces, alors que ceux-ci sont impopulaires? L’initiative de recherche portant sur le rôle du leadership politique dans construction d’un urbanisme durable (Davis, 2019)(16) révèle les différentes stratégies et tactiques ayant mené aux décisions politiques transformationnelles de certaines villes et métropoles. Parmi celles-ci, on souligne l’attente de l’ouverture de fenêtres d’opportunités, le recours à l’expertise technique, les projets pilotes, le choix et l’habilitation des alliés, le cadrage favorable des enjeux, la compensation des inconvénients, ainsi que le travail multiniveau. Les études de cas dévoilent également les différents parcours possibles vers l’adoption de choix politiques désirables du point de vue de la durabilité des transports, mais qui peuvent d’abord être impopulaires. Ainsi, une initiative peut être mise de l’avant à la suite d’une décision « choc », d’une série de changements incrémentaux, d’un effort de collaboration, d’un conflit, de négociations ouvertes, de jeux de coulisses, etc. Bref, la meilleure option dans un contexte donné n’est pas inatteignable; il s’agit de l’identifier, de bien la documenter, et de déployer les moyens afin d’obtenir les appuis nécessaires, de sorte qu’elle soit connue et reconnue comme étant souhaitable par la population et par les représentant.e.s des paliers de gouvernement concernés.
Appartenant à la théorie des jeux, ce phénomène se nomme le paradoxe de Braess, provenant du mathématicien du même nom (Braess, 1968).
Plus précisément, ce scénario « pollueur-payeur » et « utilisateur payeur » permettrait de réduire les émissions de GES de 2,22 Mt éq. CO2, alors que la Politique de mobilité durable du Gouvernement du Québec vise une réduction de 8,48 Mt éq. CO2 d’ici 2030 (TRANSIT, 2018, p. 42).
L’encyclopédie en ligne de transportation demand measures du Victoria Transport Policy Institue offre un inventaire exhaustif des outils de gestion de la demande en transports (https://www.vtpi.org/tdm/tdm12.htm).